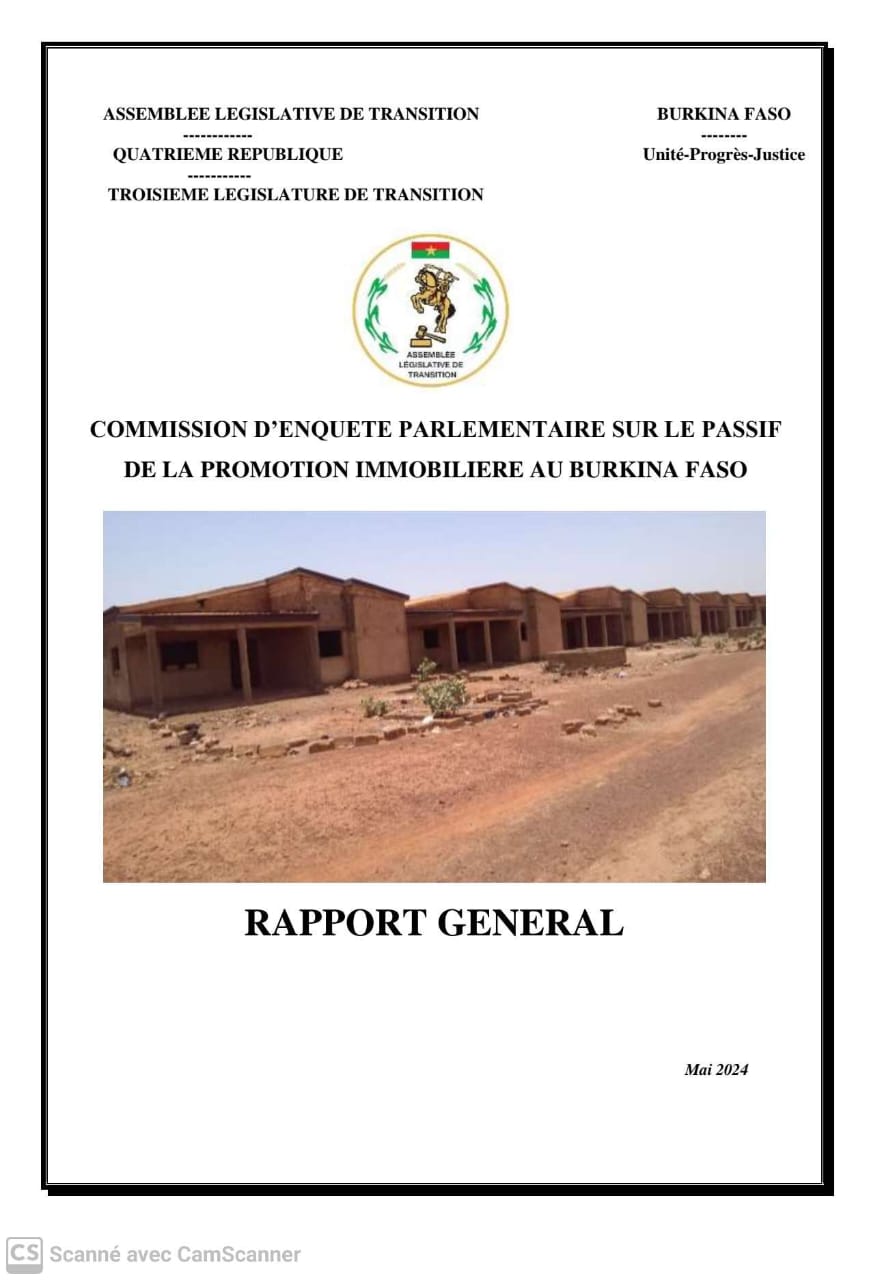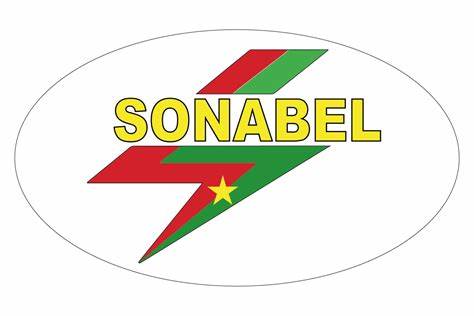Ils ont d’abord éliminé Sankara et douze de ses compagnons. Ils
ont ensuite abattu certains chefs militaires proches du leader de la
Révolution. «Lorsque les tirs ont cessé au Conseil, j’ai essayé de
sortir la tête pour voir; j’ai aperçu Hyacinthe Kafando, Nabié N’soni dit
«quatre roues». J’ai rejoint mon unité (l’Escadron Motocycliste Commando-EMC),
basé en face du Conseil de l’Entente, de l’autre côté de la voie, non loin du
domicile de Diendéré Gilbert. C’est là que nous avons reçu les ordres de notre
chef, Ouédraogo Tibo», explique un militaire. Ils vont ensuite faire parler le langage des
armes.
Des militaires du Centre national d’entrainement commando (soldats
du Conseil et de l’EMC), dont certains venaient de terminer la sale besogne au
Conseil de l’Entente, se dirigent, le soir du 15 octobre, vers le camp CRS
alors à Gounghin et qui abritait la FIMATS et l’Ecole de police. Ils vont
tenter, de façon subtile, d’empêcher tout renfort susceptible de perturber
l’élan du coup d’Etat. Et d’obtenir la «tête» du chef de corps ! Un
élément de ce camp a vu venir le danger. «Aux environs de 17h, dit-il, j’étais
dans la cour du camp. Le chef de poste, à l’entrée du camp face au monument,
m’a appelé. Je me suis déporté vers lui. Il m’a montré du doigt une troupe
militaire qui arrivait du côté sud. Ils étaient dans un véhicule, tenues
bariolées avec bérets renversés. Arrivé à la hauteur du rond-point, le véhicule
s’est immobilisé. Le chef d’équipe est descendu. Les éléments qui étaient à
l’arrière dans le pick-up sont également descendus. Ils étaient une douzaine.
Ils ont commencé à progresser, à pieds, vers nous, à l’entrée principale du camp».
Les éléments du camp CRS se mettent en alerte maximale. «J’ai crié «Halte» à ceux qui avançaient. Ils ont
obtempéré en s’arrêtant. Leur chef s’est avancé seul, les mains en l’air, son
arme, une kalachnikov crosse escamotable, à la poitrine». Et là, les militaires
du CNEC vont «tout faire» pour ne pas attirer la «foudre» des éléments du camp
CRS. «A ma hauteur, explique le témoin, leur chef d’équipe s’est exprimé en ces
termes «Nous sommes des amis. Deux hommes se battent en ville pour le pouvoir.
L’un est déjà mort. Nous sommes venus
pour vous aider à sécuriser». Celui qui parle ainsi est un «Adjudant» du CNEC,
l’un des hauts responsables de l’Escadron motocycliste commando (EMC). Des
éléments du CNEC venaient d’abattre, il y a environ trente minutes, le
Président Sankara et douze de ses compagnons. «Il était réputé à l’époque, mais
je ne le connaissais pas physiquement. Je l’ai personnellement reçu et on a
même échangé. (…) Après, les agents m’ont dit que c’était l’Adjudant Tibo», affirme
l’un des éléments clés du camp CRS. Le CNEC réussira ainsi à infiltrer le camp.
Le ver était donc dans le fruit. Et là, les choses vont aller vite, très vite.
D’autres militaires du CNEC s’étaient dissimulés dans le quartier. Ils avaient,
en réalité, encercler le camp. «L’Adjudant Tibo ordonne, quelques temps après,
un rassemblement de tous nos éléments. Pendant que nous étions au
rassemblement, nous avons aperçu ses hommes venir de tous les côtés. Certains
ont escaladé le mur et sont rentrés. D’autres sont rentrés par les différentes
portes du camp et même en véhicule». L’Adjudant va maintenant tenter de prendre
le contrôle total du camp. «Une fois au rassemblement, explique un témoin, il
s’est exprimé de façon autoritaire. Il a dit : «Pour compter de l’heure où
nous sommes, c’est moi qui prend le commandement ici. Si vous apercevez votre
chef de corps Sigué, abattez-le !». Ensuite, il a dit : «Retournez à
vos postes». Et pour éviter toute surprise désagréable, il a fait appuyer tout
notre dispositif par ses éléments (…) Nous étions dès lors sous son
commandement». Un militaire de l’EMC, qui était dans le commando conduit par
l’Adjudant Tibo, s’en souvient : «Arrivés, les policiers avaient un
dispositif tout autour du mur (…) . Tibo est allé avec quelques éléments dans
la guérite (…). Les gradés de la police étaient réunis là-bas. Étant le plus
gradé après lui, j’étais Sergent à l’époque, j’ai continué dans la cour avec le
véhicule. J’ai débarqué des hommes et je les ai répartis tout autour(…). Là où
il y avait un policier, j’ajoutais un de nos éléments militaires». Un autre
soldat, qui a vécu les évènements, renchérit : «Le 15 octobre 1987, c’est
Tibo qui nous a briefés pour la prise du camp abritant la Force d’intervention
du ministère de l’Administration territoriale et de la Sécurité (FIMATS). Il a
bel et bien conduit la mission».
Le chef de corps de la FIMATS, Vincent Sigué, qui sentait venir le
danger, a pu s’échapper avant l’arrivée du commando. Mais pour conforter leur
assise, ils vont tenter de le diaboliser : «Diendéré Gilbert nous a dit
que Sigué Vincent avait un plan machiavélique, que des documents ont été
trouvés chez lui, faisant état d’une prise de pouvoir et d’un changement de nom
du pays qui deviendrait l’empire du Mandingue», confie un militaire de la FIMATS.
Sigué a ensuite été localisé : «Dans la nuit du 16 octobre, j’ai
accompagné Ouédraogo Tibo au Conseil de l’Entente. Il m’a même donné le mot de
passe là-bas et nos éléments de la FIMATS patrouillaient avec leurs éléments,
ceux de l’Escadron motocycliste commando. Au Conseil, il m’a présenté à
Diendéré Gilbert qui m’a salué et m’a remercié pour le travail qu’on abat.
Ensuite, il m’a amené à la Cité An III en face du canal dans une villa où il y
avait une carte. Il m’a désigné un point sur ladite carte vers la frontière du
Ghana où Sigué Vincent venait d’être localisé». Ce dernier sera abattu quelques
jours après.
Le chef de corps de l’Escadron de transport et d’intervention
rapide (ETIR) a également été abattu. Un militaire de cette unité, au moment
des faits, témoigne : «Le chef de corps Koama Michel (qui s’était habillé
pour le sport de masse) est rentré chez lui pour s’habiller en tenue militaire
et nous rejoindre. Mais il n’est pas revenu (…)». Selon plusieurs témoignages,
«il a été suivi par le Lieutenant Somé Gaspard sur une moto, puis ils ont
entendu la détonation du coup de feu». Le gérant du maquis «Chez Jean Paul», situé juste à côté, affirme avoir vu «Gaspard
revenir de chez Koama Michel après le coup de feu, prendre une bière boire. Il
est même reparti sans payer. Il est clair que c’est Somé Gaspard qui a abattu
Koama Michel dans sa chambre pour éviter tout renfort à Ouagadougou». Des
acteurs clés de cette affaire sont formels : «Il y avait une coordination
après l’action du Conseil pour neutraliser le chef de corps de l’ETIR par
l’intermédiaire de Somé Gaspard et du Sergent Maïga Hamidou». Ces derniers se
sont affichés comme les nouveaux patrons de l’ETIR. «Quand Maïga dit Makachi
est revenu du Conseil, il avait beaucoup de pouvoir ; on ne savait même
pas entre lui et Gaspard qui commandait le corps. Ils avaient des affinités,
c’était une complicité terrible», explique un militaire qui a suivi de près les
évènements. Et un autre d’ajouter ceci : «Après le 15 octobre 1987, j’ai
eu à échanger plusieurs fois avec Somé Gaspard. Le 15 octobre, lorsque je l’ai
croisé à la station BP Kologh-Naba, il partait au Conseil pour rendre compte à
Diendéré Gilbert de ce qui s’était passé à l’ETIR, à Kamboinsin(…). Il m’a dit
qu’il avait tué son chef de corps Koama Michel dans sa maison lorsqu’il
s’habillait en tenue militaire et de dos. J’ai pris une bouteille de whisky
boire et je suis reparti au camp CRS».
La nuit du 15 octobre, la situation était très préoccupante. Le
Lieutenant Gilbert Diendéré demande du renfort. «Dans les environs de 22
heures, il est venu aux transmissions. Il m’a fait transmettre un message à Pô
demandant du renfort qui est arrivé tard dans la nuit. (…) Il m’a envoyé dans
le bâtiment du Secrétariat du CNR pour dire à Sawadogo Boureima d’ouvrir la
ligne de Kamboinsé (…) Après exécution, je suis revenu aux transmissions rendre
compte à Diendéré Gilbert. La ligne étant ouverte, je suis revenu trouver
Diendéré Gilbert en train de communiquer avec Kamboinsé». Mais avec qui
parlai-t-il ? Un autre agent du service des transmissions apporte des
éléments de réponse : «Des appels que j’ai reçus le 15 octobre 1987 dans
la nuit et le lendemain, je me souviens de ceux de Somé Gaspard qui appelait
fréquemment le Conseil et je lui passais Diendéré Gilbert».
La suite ? Une vague d’arrestations. «Je me suis rendu au
Conseil de l’Entente dans la matinée du 16 octobre pour rencontrer le Capitaine
Blaise Compaoré à sa demande (…) On m’a fait attendre sous les arbres qui se
trouvaient face au bureau qu’occupait le Président Sankara. Pendant que j’étais
assis, l’eau ensanglantée coulait depuis le bureau, à travers le goudron et
atteignait les arbres. (…) J’ai été rejoint par Gilbert Diendéré à qui j’ai
demandé d’ «assurer la sécurité» de Ousséni Compaoré (commandant à la
gendarmerie) et de sa famille parce que ses éléments passaient et la femme
était traumatisée. Je l’ai informé que Ousséni était à Ouahigouya avec (feu)
Capitaine Laye Dihiré. Il a dit qu’il allait le faire. Ce qui a abouti à son
arrestation avec le Capitaine Laye Dihiré, tous deux détenus au Conseil de
l’Entente dans une villa. Il y avait également dans cette villa Ernest Nongma
Ouédraogo et le Commandant Abdoul Salam Kaboré». Cette information est
confirmée par un autre militaire qui assurait également la garde: «Parmi les
prisonniers qu’on gardait (Diendéré Gilbert venait de temps en temps voir si
les hommes de garde sont là), il y avait Ernest Nongma Ouédraogo, deux sous-officiers
de la base aérienne, un de ma classe, un certain Somé, qui était menotté et
deux Libériens dont un de teint clair et l’autre de tient noir. Je ne connais
pas leurs noms. Les militaires de la base aérienne étaient ensemble dans une
pièce, Ernest Nongma Ouédraogo dans une autre pièce et les deux Libériens
également dans une autre». Des faits, tout aussi graves les uns que les autres,
vont se produire par la suite.
Par Hervé
D’AFRICK
=========================
Le jeu trouble de la France
Les autorités
françaises se sont donné un coup de pub le 24 février dernier. Elles ont fait
circuler une information tendant à dire que la France est très soucieuse de la
justice dans l’affaire Thomas Sankara. Et que, dans ce cadre, elles venaient de
transmettre au Burkina «un lot de huit documents confidentiels», relatifs aux
évènements du 15 octobre 1987. Mais en réalité, il s’agit d’une simple
opération de com’ ! Il ne s’agit pas de documents «ultra confidentiels»
qui viennent d’être déclassifiés comme on tente de le faire croire. Ces
documents, tout comme les deux premiers lots transmis à la Justice burkinabè,
font parties d’archives «diplomatiques» françaises susceptibles d’être
consultés par le public. D’ailleurs, certains citoyens français, qui avaient
exprimé le vœu de les consulter auprès des autorités françaises, ont pu le
faire sans problème. Et pour tout dire, il n’y a presque rien de croustillant
dans les deux premiers lots. Il ne s’agit pas, en réalité, d’archives
déclassifiées. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les huit nouveaux
documents apportent quelque chose d’exceptionnel. En réalité, la France refuse,
jusque-là, de fournir les vrais documents susceptibles d’apporter un plus à
l’évolution du dossier. Il était prévu l’envoi, en fin 2018, d’un troisième lot
de documents, «les vrais documents classifiés, qui nécessitent donc une
procédure exceptionnelle de déclassification», mais ça n’a pas été fait. Nous
avons également appris que la justice burkinabè avait souhaité se rendre en
France afin de procéder à certaines auditions. Mais là aussi, les autorités françaises
se sont montrées réticentes. Une commission rogatoire internationale a alors
été initiée. Et même là, certaines personnes nommément visées dans cette
commission rogatoire, transmise aux autorités françaises, n’ont pas été
auditionnées. L’instruction a donc été bouclée et le dossier transmis à la
chambre de contrôle. Pourquoi la France joue-t-elle ce double jeu ?
Affaire à suivre.
H. D